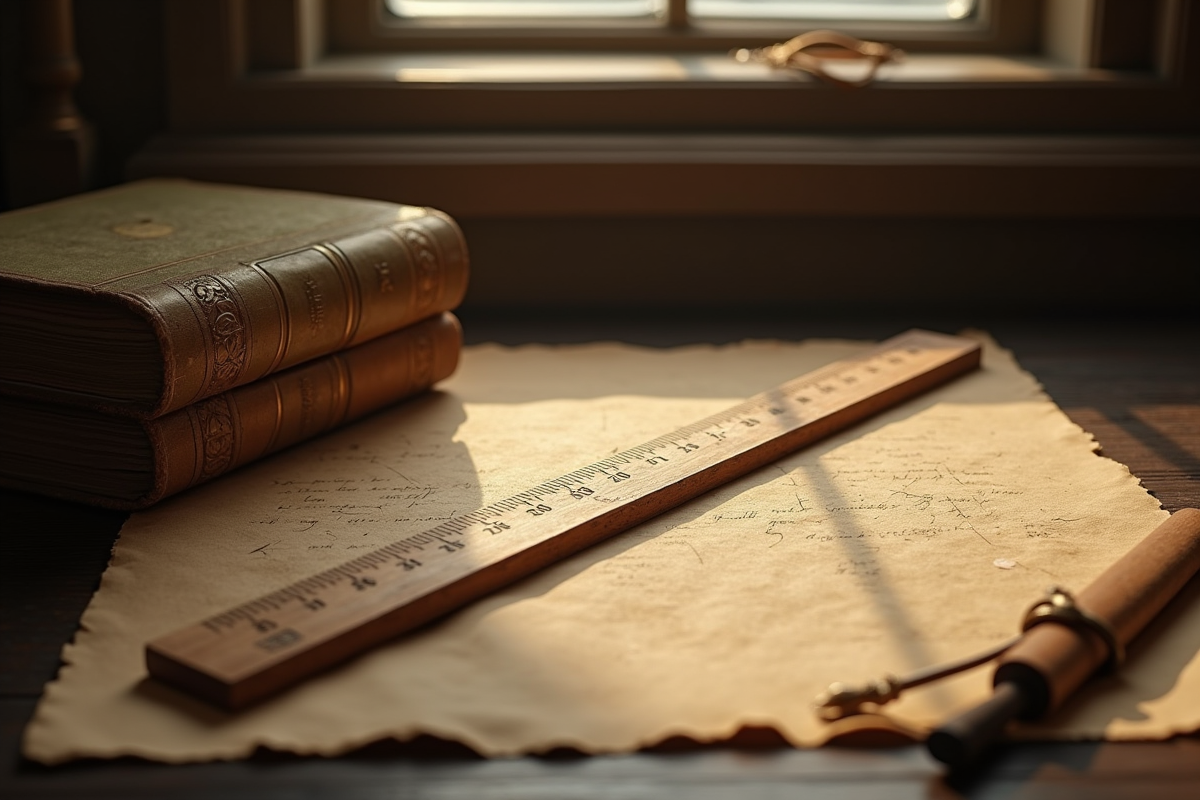En 1879, la première serviette hygiénique commerciale voit le jour, mais reste longtemps inaccessible à la majorité des femmes en raison du coût et des préjugés sociaux persistants. Pendant des siècles, les menstruations ont été associées à des interdits religieux et à des croyances erronées, parfois jusqu’à l’exclusion temporaire des femmes de la vie sociale.Certains pays maintiennent encore des pratiques discriminatoires liées au cycle menstruel, malgré l’évolution des connaissances médicales et l’apparition de solutions innovantes. L’histoire de ces pratiques révèle un enchevêtrement complexe entre progrès technique, représentations culturelles et résistances sociales.
Les premières traces des menstruations dans l’histoire humaine
Depuis les premières civilisations, le regard porté sur les menstruations fluctue, oscillant entre pragmatisme et superstition. Dans l’Égypte ancienne, les médecins traitent le cycle féminin sans détour. Les papyrus médicaux témoignent d’une approche concrète : les observations sont consignées, les traitements proposés, sans que la honte ne vienne masquer le sujet. Le sang menstruel trouve même une place dans certains rituels de guérison, valorisé pour des vertus supposées, loin du tabou.
La Grèce antique apporte une vision différente. Sous la plume d’Hippocrate, la médecine explique les règles comme une purification du corps féminin, une nécessité biologique. Cette idée, selon laquelle il faut évacuer les fluides pour rester en bonne santé, s’ancre profondément dans les mentalités et perdure bien après l’époque grecque.
À Rome, le scepticisme laisse place à la défiance. Pline l’Ancien, dans son Histoire naturelle, compile les prétendus méfaits du sang menstruel : il altérerait le vin, corroderait le métal, ferait périr les récoltes. Des croyances sans fondement, martelées jusqu’à devenir des certitudes, qui influenceront durablement les sociétés occidentales.
Pour mieux saisir la diversité des regards portés sur les règles, voici quelques points qui illustrent cette évolution :
- La survenue des premières règles donne lieu à des interprétations variées, entre savoir médical et superstitions locales.
- L’histoire de la règle éclaire la trajectoire des sociétés, de la reconnaissance scientifique à la stigmatisation sociale.
Qui a inventé les protections périodiques ? Un regard sur les grandes innovations
La recherche de protections hygiéniques accompagne la vie des femmes depuis toujours, mais il faut attendre la révolution industrielle pour voir naître les premières alternatives commercialisées. Au XIXe siècle, les linges réutilisables, confectionnés à la main, circulent discrètement en Europe et aux États-Unis. Leur efficacité reste relative, et la crainte d’être remarquée ne quitte pas les utilisatrices. Le véritable changement intervient au début du XXe siècle, avec l’apparition de la serviette hygiénique jetable, résultat de l’initiative de quelques industriels audacieux.
En 1931, Leona Chalmers, Américaine ingénieuse, fait breveter la première cup menstruelle en caoutchouc vulcanisé. L’idée est avant-gardiste, mais le contexte social ne favorise pas son adoption, et la Seconde Guerre mondiale interrompt son essor. Peu après, le médecin Earle Haas développe le tampon avec applicateur. Dès 1934, la société Tampax lance la production à grande échelle, offrant à de nombreuses femmes une nouvelle liberté de mouvement et une autonomie inédite.
Le XXIe siècle marque l’arrivée de la culotte menstruelle, résultat d’une alliance entre innovation textile et souci de praticité. Réutilisable, discrète, elle répond aux attentes de celles qui cherchent des solutions respectueuses du corps et de l’environnement, séduisant une génération avide de changements durables.
Pour mieux appréhender cette évolution, voici les principales étapes jalonnant l’histoire des protections périodiques :
- Serviettes hygiéniques jetables : commercialisées dès le début du XXe siècle.
- Cup menstruelle : inventée par Leona Chalmers et brevets déposés en 1931.
- Tampon hygiénique : conçu par Earle Haas, diffusé par Tampax à partir de 1934.
- Culotte menstruelle : adoption croissante au XXIe siècle.
Le marché s’élargit, chaque innovation traduisant une progression du regard porté sur le corps féminin et la santé menstruelle.
Tabous et croyances : comment les règles ont façonné les sociétés à travers le temps
Le cycle menstruel dépasse la simple réalité biologique : il façonne des normes, des exclusions, des mythes. Les religions monothéistes perpétuent la notion d’impureté. Dans la Bible ou la Torah, il est prescrit que la femme menstruée doit s’éloigner, exclue temporairement des rituels et parfois même du foyer. Ces règles religieuses imposent une mise à l’écart bien au-delà du domaine spirituel.
Dans de nombreuses sociétés, les croyances s’ancrent dans la vie quotidienne. En Afrique, le fait d’avoir ses règles conduit encore des jeunes filles à abandonner l’école. Au Népal, la pratique du Chaupadi contraint les femmes à s’isoler dans des abris précaires chaque mois, sous la menace de porter malheur à leur famille. En Inde ou en Afghanistan, les interdits abondent : accès limité à l’eau, interdiction de cuisiner, peur de la stérilité.
Le passage à la modernité ne suffit pas à évacuer ces représentations. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, certains médecins européens avancent l’idée que les femmes menstruées produisent des ménotoxines, substances imaginaires accusées de provoquer des maladies. Il faudra la rigueur scientifique de chercheurs comme De Graaf, qui met en évidence les follicules ovariens, ou du docteur Ogino, pionnier dans la compréhension de l’ovulation, pour commencer à dissiper ces croyances infondées.
À travers ces exemples, difficile d’ignorer que les règles ont souvent servi de prétexte à l’exclusion et à la marginalisation, participant ainsi à la construction d’une identité féminine marquée par l’interdit.
Vers une déstigmatisation : où en sommes-nous aujourd’hui avec la perception des règles ?
Le regard social se transforme, pas à pas. Ce qui était caché s’exprime désormais sans détour. Des associations, des personnalités engagées et des campagnes médiatiques agissent pour lever le voile. Les réseaux sociaux donnent de l’ampleur au mouvement, recueillant témoignages, actions éducatives et créations artistiques. Le tabou, longtemps ancré, commence à se fissurer.
Ces évolutions se traduisent concrètement. Plusieurs établissements scolaires et universités en France proposent la gratuité des protections périodiques. En Écosse, cette démarche va jusqu’à la gratuité universelle. Quelques entreprises s’essaient à intégrer le cycle menstruel dans leur politique de gestion. Même le langage évolue : les mots s’adaptent pour décrire une réalité longtemps passée sous silence.
Sur le terrain, la sensibilisation s’intensifie. Médecins, enseignants et associations interviennent dans les collèges, déconstruisent les idées reçues et encouragent le dialogue. La menstruation s’installe dans l’espace public : elle ne relève plus seulement de l’intime, elle devient une question de santé publique et de justice sociale.
Bien sûr, tout ne change pas d’un coup, surtout là où l’accès à l’information reste limité. Pourtant, la dynamique est lancée. Les jeunes, formés à l’égalité et à la parole libre, bousculent les habitudes et portent la voix de celles qui ont longtemps été réduites au silence.
Le chemin vers l’acceptation pleine et entière des menstruations comme fait social universel n’est pas achevé. Mais aujourd’hui, la parole circule, la gêne s’efface, et cela suffit déjà à bouleverser le paysage. Qui aurait cru, il y a cent ans, à une telle révolution ?